
Traumatologie du ski et du snowboard
La pratique des sports des neiges n’est pas sans risque. Près de 150 000 personnes se blessent chaque année.
Secrétariat du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00 au 07 67 05 04 02

Chaque année, 8 millions de Français pratiquent le ski ou le snowboard. Cependant, ces sports de glisse ne sont pas sans risque : on dénombre près de 150 000 blessés par an. Les débutants sont particulièrement vulnérables, avec un risque d’accident deux fois plus élevé durant leurs quatre premiers jours sur les pistes.
La gravité des blessures est directement liée à l’énergie de l’impact, donc à la vitesse. À titre indicatif, la vitesse moyenne d’un skieur en station se situe entre 30 et 60 km/h, mais peut atteindre 100 km/h pour un très bon skieur.
Cette vitesse a un impact direct sur la distance de freinage :
9 mètres pour s’arrêter à 25 km/h
12 mètres à 47 km/h
Plus de 20 mètres au-delà de 50 km/h
Bien que 8 % des blessures surviennent sur les remontées mécaniques, les fixations de ski sont une cause majeure de traumatismes graves, en particulier au genou. Un mauvais réglage peut provoquer un non-déclenchement lors d’une chute ou, à l’inverse, un déclenchement intempestif.
Chaque année, les médecins de montagne prennent en charge environ 200 000 blessés, dont 35 % pour des entorses et 25 % pour des fractures.
Chez l’enfant, les fractures sont plus fréquentes en raison de la fragilité des cartilages de croissance. Plus l’enfant est jeune, plus les fractures se situent autour du genou, pouvant nécessiter des techniques chirurgicales très spécifiques.
L’évolution du matériel, avec des chaussures montantes, a modifié la nature des blessures : les fractures de la cheville ont laissé place à celles du tibia et du péroné, souvent plus complexes à consolider.
Chez la femme, la morphologie augmente le risque d’entorse du genou, notamment la rupture du ligament croisé antérieur (LCA). Si cette lésion était typique de l’adulte, elle touche désormais aussi les enfants et requiert souvent une prise en charge chirurgicale adaptée.
En snowboard, les chutes étant souvent réceptionnées sur les mains, les traumatismes du membre supérieur prédominent : fractures du poignet et luxations de l’épaule ou du coude.
Un pic d’accidents est observé en début de journée. Il est souvent lié à plusieurs facteurs combinés : un manque d’échauffement, la fatigue du voyage et une neige plus dure et verglacée le matin.
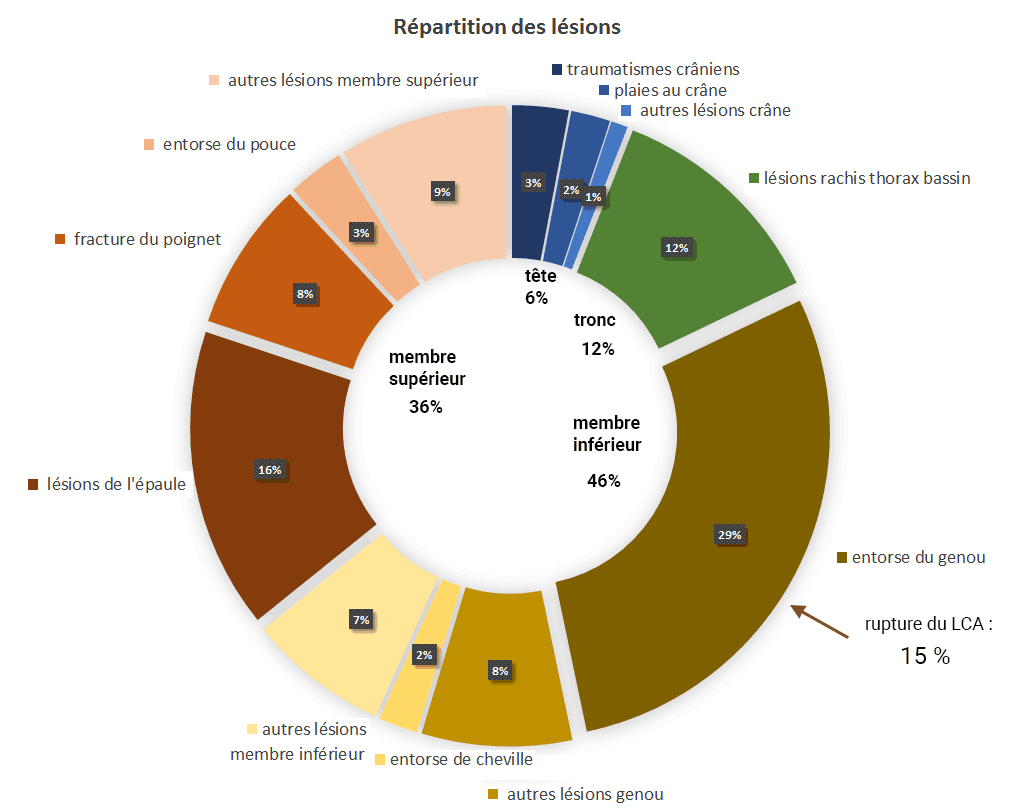
Un deuxième pic d’accidents survient en fin d’après-midi, généralement causé par la fatigue, des pistes dégradées et une neige plus lourde et difficile à skier. De manière générale, les débuts et fins de séjour sont des périodes particulièrement à risque.
Grâce aux progrès du matériel (chaussures plus hautes et rigides, fixations de sécurité), les fractures de la jambe et les entorses de la cheville sont devenues beaucoup plus rares. En contrepartie, les contraintes se sont déplacées plus haut, faisant du genou l’articulation la plus exposée aux blessures.
Aujourd’hui, l’entorse du genou, et plus précisément la rupture du ligament croisé antérieur (LCA), est la blessure la plus fréquente et la plus redoutée des sports d’hiver, touchant les skieurs de tous les niveaux.
L’entorse du genou en chiffres
33 % : Elle représente un tiers de toutes les blessures sur les pistes.
x 3,5 : Les femmes ont un risque 3,5 fois plus élevé de subir cette blessure.
45 % : Près de la moitié de ces entorses sont directement liées à un mauvais réglage des fixations.
Plusieurs facteurs expliquent la hausse de la fréquence de cette lésion depuis les années 80 :
L’équipement moderne : Les chaussures de ski, très rigides, protègent la cheville mais reportent l’intégralité des forces de torsion sur le genou.
Les fixations mal réglées : C’est la cause principale. On estime que près de 50 % des fixations ne sont pas réglées selon les normes de sécurité.
Les facteurs de risque féminins : Le risque accru chez les femmes s’explique par des raisons anatomiques (bassin plus large, genoux plus en X, hyperlaxité ligamentaire) et une protection musculaire de l’articulation qui peut être moins développée.
Le mécanisme de la chute : Contrairement aux idées reçues, la rupture survient souvent à faible vitesse, lors d’une simple torsion ou d’une chute anodine (en descendant d’un télésiège, par faute technique…).
Le manque de préparation physique : Des muscles fatigués ou non préparés protègent mal l’articulation, augmentant drastiquement le risque.
Le ligament croisé antérieur est un stabilisateur essentiel du genou. Il ne cicatrise que très rarement de lui-même. En l’absence d’un traitement adapté, les conséquences à long terme sont sérieuses :
Instabilité chronique du genou, provoquant une gêne dans la vie de tous les jours.
Risque élevé d’arthrose précoce de l’articulation.
Difficulté ou impossibilité de reprendre les sports à pivot (ski, tennis, football, etc.).
Appréhension psychologique durable par peur d’une nouvelle blessure.
L’entorse du genou n’est pas une fatalité. Deux gestes simples permettent de réduire considérablement les risques :
Une préparation physique débutée plusieurs semaines avant le séjour.
Un contrôle et réglage des fixations par un professionnel chaque saison.
Lorsqu’une rupture du LCA est diagnostiquée, une intervention chirurgicale est le plus souvent recommandée pour reconstruire le ligament, stabiliser le genou et éviter les complications futures.
Pour en savoir plus sur la prise en charge chirurgicale de la rupture du ligament croisé antérieur…
Toute chute sur l’épaule peut entraîner une fracture ou une déchirure ligamentaire. Le diagnostic n’est pas toujours immédiat : la douleur, d’abord modérée, peut s’intensifier fortement une fois au repos. C’est souvent l’apparition d’une incapacité à bouger l’épaule (impotence fonctionnelle) qui pousse le skieur à consulter.
La luxation acromio-claviculaire C’est une perte de contact entre la clavicule et l’acromion (partie de l’omoplate), survenant lors d’une chute directe sur le côté de l’épaule. Selon la gravité, les ligaments sont soit distendus, soit rompus. En cas de rupture, la clavicule remonte et forme une bosse caractéristique appelée « touche de piano ».
Traitement : Une simple immobilisation peut suffire si le déplacement est minime. Si la clavicule est trop ascensionnée, une opération est recommandée pour la repositionner et permettre aux ligaments de cicatriser correctement, évitant ainsi douleurs chroniques et gêne fonctionnelle.
La fracture de la clavicule Très fréquente, elle survient aussi après une chute sur l’épaule. Elle touche le plus souvent le milieu de l’os (tiers moyen). Le diagnostic, suspecté face à une déformation et une douleur précise à la palpation, est confirmé par radiographie. Des examens complémentaires (arthroscanner, IRM) sont parfois nécessaires pour rechercher des lésions associées.
Traitement : Le plus souvent, une immobilisation par attelle pendant 6 semaines suffit. Une chirurgie peut être nécessaire en cas de déplacement majeur ou de complications vasculaires ou neurologiques. Pour les fractures proches de l’épaule (quart externe), la chirurgie est quasi-systématique pour éviter l’absence de consolidation (pseudarthrose).
La luxation de l’épaule (articulation principale) Il s’agit du déboîtement de la tête de l’humérus hors de la glène (cavité de l’omoplate). Après un premier épisode, l’épaule peut devenir instable, menant à des luxations ou subluxations (micro-déboîtements) à répétition. Le patient développe alors une « appréhension » : la peur de se déboîter l’épaule lors de gestes anodins.
Traitement : La répétition des luxations abîme l’articulation. La stratégie thérapeutique (rééducation ou chirurgie) est décidée au cas par cas, selon l’âge, le niveau sportif, le nombre d’épisodes et les lésions associées.
L’entorse du pouce (le « pouce du skieur ») Cette blessure est fréquente et souvent sous-estimée. Le mécanisme typique est une chute où la dragonne du bâton emporte le pouce vers l’extérieur. La douleur sur le côté interne du pouce peut sembler mineure au début, mais la gêne s’aggrave les jours suivants.
⚠️ Attention : Une entorse grave du pouce non traitée rapidement peut laisser des séquelles importantes (douleur chronique, perte de force). Une consultation médicale précoce est essentielle.
La fracture du scaphoïde Cet os du poignet peut se casser lors d’une chute sur la paume de la main. La douleur étant peu intense, le diagnostic est souvent retardé. Le médecin l’évoque en retrouvant une douleur à la palpation d’un point précis du poignet (la « tabatière anatomique »). Le diagnostic tardif complique le traitement, car cet os a une mauvaise cicatrisation naturelle, rendant la chirurgie souvent nécessaire.
Un choc violent contre la neige dure, un obstacle ou un autre skieur peut causer des blessures graves (fractures des côtes, des vertèbres, du crâne). Le risque majeur est l’apparition d’un hématome cérébral, qui peut survenir même plusieurs heures après le choc et constitue une urgence chirurgicale vitale.
Le port du casque est indispensable pour limiter les conséquences, mais ne remplace pas la prudence et la maîtrise de sa vitesse. Toute perte de connaissance ou comportement anormale après une chute sur la tête impose une surveillance médicale immédiate.
La traumatologie du ski et du snowboard n’est pas une fatalité. Comment prévenir ces accidents ?